Les scieurs de long
Avant le départ
D'après la tradition, les départs avaient lieu à Notre-Dame de septembre, le 8 ou à la Saint-Michel le 29 septembre, et les retours à la Saint-Jean d'été le 24 juin. Dans la réalité rien d'aussi rigide, les départs s'échelonnaient de septembre à décembre et les retours d'avril à juillet. L'absence durait 8 à 9 mois.
On appelait cette émigration temporaire : émigration d'hiver ou de morte-saison par opposition à l'émigration d'été. Exceptionnellement des scieurs de long du Limousin et de la Creuse ont pratiqué l'émigration d'été pour accompagner leurs compatriotes maçons ceux du bâtiment qui limousinaient.
En général, ils rentraient au pays chaque été. Quelques uns sautaient deux ou trois ans à cause de l'éloignement ou parmi les jeunes mariés soucieux de rapporter un pécule plus important et d'éviter toute naissance, dès les premières années du mariage. Cet exode saisonnier rythmait et déséquilibrait la vie locale, sociale et économique, exemple : les baptêmes et naissances enregistrés entre avril et juillet.
Autour de l'émigration, il y avait toute une organisation, elle était bien encadrée. Un chef d'équipe, le patron, recrutait la main-d'œuvre, lors des foires - d'ailleurs la coutume disait que, sur certaines foires, il y avait plus de patrons scieurs de long que de marchands de bestiaux - lors des fêtes patronales, dans les cabarets... tout simplement entre parents ou gens du même village. Le patron se chargeait de toutes les démarches.
En plus de l'embauche, il cherchait le travail, traitait avec l'employeur, qui adjudicataire de coupe, qui marchand de bois, qui exploitant forestier, se chargeait des conditions de travail, des rémunérations. Il s'occupait des trajets, de l'hébergement et de la nourriture. A la fin de la campagne, il répartissait les gains...
Une douzaine d'hommes composaient l'équipe, la brigade, parfois moins, parfois davantage. Avant de se mettre en route, ils remplissaient des formalités d'ordre privé, administratif ou notarial. Ceux qui étaient pour se marier, le faisaient aux mois d'août, septembre ou octobre avant de partir, ainsi profitaient-ils de la présence des autres scieurs de long parents et amis.
En 1772, le curé de Sauvain enregistrait onze mariages, chiffre particulièrement élevé dû à la période de forte démographie. Ils étaient répartis sur deux mois seulement soit neuf en septembre et deux en octobre.
Sous l'Ancien Régime, ils nommaient ou élisaient les consuls. Voici un document reçu par le notaire VALEZY, le 14 septembre 1661 : contenant nomination des consuls de la parcelle de Sauvain pour l'année 1662, faite par le peuple assemblé à l'issue de la messe paroissiale, requérant les consuls sortant et en vertu d'une ordonnance des élus de Montbrison qui permet d'élire les consuls de l'année suivante, attendu que la plus grande partie des habitants sont sur le point de partir pour s'en aller à la scie.
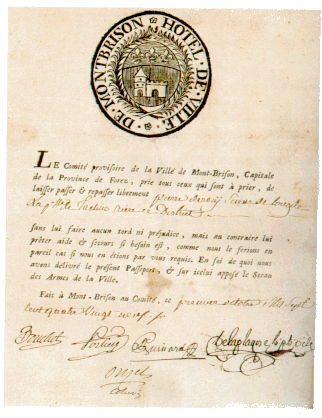 D'abord auprès des prêtres, des échevins... puis des maires, ou auprès de tout autre membre de l'autorité compétente ils se faisaient délivrer un certificat de route, un passeport : document obligatoire aussi bien pour circuler dans l'intérieur du pays qu'à l'étranger, à présenter en cas de contrôle et à faire viser : "Vu passer à la Flèche le 30 décembre 1779, Maréchal de Lucé Procureur du Roi".
D'abord auprès des prêtres, des échevins... puis des maires, ou auprès de tout autre membre de l'autorité compétente ils se faisaient délivrer un certificat de route, un passeport : document obligatoire aussi bien pour circuler dans l'intérieur du pays qu'à l'étranger, à présenter en cas de contrôle et à faire viser : "Vu passer à la Flèche le 30 décembre 1779, Maréchal de Lucé Procureur du Roi".
Le demandeur devait être bon catholique, les protestants vellaves ne pouvaient donc pas émigrer, ni hérétique, de bonne moralité, jouissant d'une honnête réputation, aucun reproche à lui faire sur sa conduite, porteur d'aucune maladie épidémique.....
Les passeports, manuscrits ou imprimés, portaient à peu près tous les mêmes formules :
Enjoignons à tous ceux qui sont préposés pour veiller au passage des gens suspects, et à la sûreté des chemins de notre Département, et prions tous ceux qui sont à prier, de laisser librement passer le dit FAURE et de même de lui donner toute aide et assistance en cas de besoin. En foi de quoi nous lui avons délivré le présent Passe-port. Cette formalité est tombée en désuétude à la fin du XIXe.
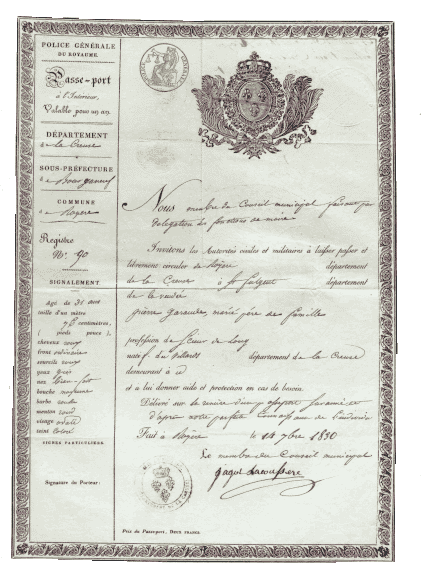 En plus du passe-port, vers 1750, a été institué le livret d'ouvrier dont ils devaient être munis.
En plus du passe-port, vers 1750, a été institué le livret d'ouvrier dont ils devaient être munis.
A gauche un passe-port fait en septembre 1830 à Royère (de Vassivière) en Creuse.
Ci-dessous la couverture du livret d'ouvrier.
Contenant
LA LOI DU 22 JUIN 1854
LE DECRET DU 30 AVRIL 1855 ET LA LOI DU 14 MAI 1851
LES ARTICLES 153 ET 453 DU CODE PENAL
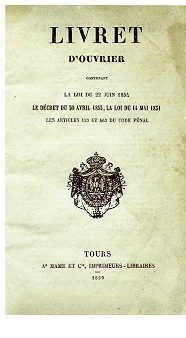
Malgré la dépense, ils n'hésitaient pas à se rendre chez le notaire, pour enregistrer un contrat de mariage, déclarer une transaction financière, donner procuration à leur femme ou pour le célibataire à un parent afin qu'il gère ses affaires en son absence, rédiger un testament pour la répartition de ses biens et s'enquérir de sa sépulture avec messes et aumônes pour le salut de son âme au cas où il ne reviendrait pas...
 Pour les émigrants Creusois, avant de quitter le pays, la tradition exigeait autrefois qu'on fit l'emplette d'un très vaste chapeau insigne du métier. Aux environs de 1885 un vieux chapelier d'Eymoutiers en avait presque l'exclusivité, et à la saison en apportait des piles importantes aux foires de la région, notamment à celles de Peyrelevade, Féniers et Faux-le-Montagne. Les sitaires auvergnats portaient le même couvre-chef. Il préservait l'homme, debout au pied du chevalet, de la chute de la sciure sur le visage. Fabriqué en laine du pays, ce feutre était imperméable à la pluie et si souple que les scieurs de long le roulaient en coussinet et le plaçaient sur leur épaule pour amortir le dur contact des arbres abattus qu'ils transportaient.
Pour les émigrants Creusois, avant de quitter le pays, la tradition exigeait autrefois qu'on fit l'emplette d'un très vaste chapeau insigne du métier. Aux environs de 1885 un vieux chapelier d'Eymoutiers en avait presque l'exclusivité, et à la saison en apportait des piles importantes aux foires de la région, notamment à celles de Peyrelevade, Féniers et Faux-le-Montagne. Les sitaires auvergnats portaient le même couvre-chef. Il préservait l'homme, debout au pied du chevalet, de la chute de la sciure sur le visage. Fabriqué en laine du pays, ce feutre était imperméable à la pluie et si souple que les scieurs de long le roulaient en coussinet et le plaçaient sur leur épaule pour amortir le dur contact des arbres abattus qu'ils transportaient.
Ils partaient généralement entre 16 et 50 ans, mais il a été relevé dans des passeports des départs dès l'âge de onze ans et jusqu'à soixante ans. Ces tout jeunes gamins, ces grouillots, moitié domestiques moitié apprentis, étaient employés à de menues besognes, et souvent à des tâches ingrates.
Parfois, au début de leur mariage des jeunes femmes se sont jointes à la brigade des scieurs de long, elles se chargeaient de la préparation des repas, de l'entretien, donnaient quelques coups de main sur le chantier.
